Dernières nouvelles du Mac Orlan (1)
- julienphilippe4
- 7 mars 2022
- 7 min de lecture
Dernière mise à jour : 9 mars 2022
Premier chapitre d'un récit fantastique ancré dans le Brest de 1980. Le Mac Orlan est un cinéma de la ville que j'ai toujours trouvé très beau (du moins selon les canons atypiques voire brutalistes de la beauté architecturale brestoise). Il y est question du Grand Effacement, la disparition subite et incompréhensible de nombreux individus.

© Tous droits réservés Archives de Brest
Les gens commencèrent à disparaître à la fin novembre ou début décembre de l’année 1980, pendant ce que les anciens Bretons appelaient les mois noirs, cette période de l’année où il semble qu’on ne sortira plus de l'obscurité des jours grisâtres et des nuits d’hiver, dans la pénombre éternelle. Ce fut d’abord à peine perceptible et le phénomène à ses débuts fut davantage perçu comme une rumeur indistincte, un bruit de fond émanant, pensait-on, d’esprits malades qui extrapolaient des absences un peu trop longues, fantasmaient sur ces départs définitifs et soudains plus ou moins rêvés dans le creuset des légendes urbaines — des échappées dont la possibilité, à vrai dire, a traversé l’esprit de la plupart d’entre nous. Il fallut pourtant se rendre à l’évidence quand vinrent à manquer le camarade de classe du petit dernier, le collègue de travail connu depuis vingt ans, puis le mari, la femme, la mère ou le père ; quand les visages figés sur les avis de recherche commencèrent à parsemer les murs et les réverbères de la ville ; quand la circulation devint plus fluide et que les rues ressemblèrent progressivement à celles d’un dimanche matin de ce que l’on commençait déjà à nommer le monde d’avant. Pas une famille bientôt ne fut épargnée par la disparition d’ au moins un de ses membres et les statistiques produites par les services de gendarmerie et de police montrèrent dès le début de l’année 1981 la progression régulière des volatilisations inexpliquées. La courbe exponentielle qui s’afficha dans les journaux fit entrevoir l’ombre oubliée des récits apocalyptiques, le souvenir confus des danses macabres ; de vieilles peurs tapies dans la mémoire collective sortirent de la tombe et un grand quotidien baptisa enfin le phénomène du nom un peu grandiloquent de Grand effacement.
Chacun y allait de sa spéculation et si les Russes voire les extraterrestres étaient souvent accusés d’une campagne d’enlèvements à des fins effroyables ou farfelues, les hypothèses divines n’étaient pas oubliées : les Eglises se remplirent à nouveau, des sectes millénaristes apparurent et proclamèrent le Grand Effacement comme signe majeur de la fin des temps. On vit même des prières géantes un peu partout sur la planète, de la place Saint-Pierre à Jérusalem, ainsi qu’un suicide collectif à Stonehenge après une longue cérémonie qui dura toute une nuit (le grand prêtre, ancienne star de musique pop, se rata néanmoins et disparut la semaine suivante — une rumeur disait qu’il vivait réfugié sur une des îles de l’archipel des Hébrides). Les voyants, gourous et autres marabouts firent des affaires pendant un certain temps mais leurs piètres consolations et parfois leur propre disparition eurent bientôt raison de ce petit commerce de la détresse. Alors chacun s’habitua envers et contre tout et plus personne ne s’étonna du vide qui gagnait peu à peu les bureaux, les chantiers, les classes, les transports en commun, les stades et les centres commerciaux. Tout ralentit prodigieusement puis se délabra enfin comme un organisme gigantesque, exténué, finit par s’affaisser lentement et s’écrouler dans la poussière à la stupéfaction de tous ceux qui assistent à la chute, ébahis.
Alphonse n’était pour sa part que peu touché par la catastrophe du fait d’une vie extrêmement solitaire qui l’avait en quelque sorte préservé du chagrin causé par l’Effacement. Il compatissait certes au désespoir de ses contemporains mais n’avait à pleurer personne, ni famille (ses parents étaient morts une dizaine d’années auparavant et il n’avait ni frère, ni oncle, ni même un lointain cousin — les ramifications de son arbre généalogique étaient des impasses qui menaient au terminus Alphonse, tout le monde descend), ni réels amis, car il travaillait presque seul dans un service des Archives de la ville et ne fréquentait guère que quelques connaissances nouées dans les gradins du stade Francis Le Blé où il se rendait à chaque rencontre du Brest-Armorique. Il sentit bien que le vieux monde mourait lorsqu’il vit les travées du stade se clairsemer progressivement, les équipes manquer de remplaçants puis finalement de joueurs : ils n’étaient plus guère qu’une poignée de supporters lorsque fut annoncé au micro avant le coup d’envoi de Brest – Thionville, le 21 février 1981, que la rencontre ne pourrait avoir lieu faute de footballers. Alphonse rentra chez lui par des rues désertes où seules de rares voitures troublaient encore le silence qui régnait dorénavant sur la ville. A l’instar de tous ceux qui avaient échappé à la disparition, il ressentait une angoisse indécise, teintée de culpabilité, à ne pas savoir s’il devait se considérer comme un élu ou un maudit. Il s’arrêta un long moment devant la barre du quartier Bonne-Nouvelle où il habitait au 8ème et compta les fenêtres éclairées en fumant une cigarette. Seule une dizaine de carrés de lumière jaunâtre trouaient le grand corps noir de l’immeuble et le souvenir d’un vaisseau fantôme au château arrière illuminé dans la nuit lui remonta d’un vieil illustré d’enfance. Les fantômes ne sont pas ceux qui partent mais ceux qui restent, pensa-t-il en appelant l’ascenseur. Dans le corridor du 8ème étage qui menait à son appartement, Alphonse entendit des pleurs derrière la porte n°87, à deux appartements de chez lui — il hésita un bref instant à y frapper mais accéléra finalement le pas (il savait ne pas être le mieux placé pour ce qui relevait du lait de la tendresse humaine). Il ferma doucement la porte de l’appartement puis s’observa dans le miroir en pied après avoir accroché son imperméable : un homme déjà grisonnant d’une quarantaine d’années, le visage un peu couperosé, l’observa d’un air las ; ses yeux bleus étaient délavés, cernés d’ombres presque verdâtres sous un certain angle, et ses lèvres minces. Plus il avançait en âge, plus il lui semblait ressembler à Peter Cushing, ce que personne ne lui avait cependant confirmé (mais d’une part il ne connaissait personne, d’autre part personne peut-être ne s’intéressait plus à Peter Cushing). Alphonse ouvrit une bière, délogea Josquin, son vieux chat de gouttière, et s’installa dans le fauteuil élimé recouvert de poils après avoir allumé la radio. Un message enregistré tournait en boucle et annonçait une interruption des programmes due à un manque de personnel ainsi qu’un prochain journal d’information à 8h le lendemain matin. Alphonse éteignit le transistor et mit un disque de Jimi Hendrix sur sa platine. Il s’endormit après quelques minutes, le chat sur les genoux, au son de Castles made of sand. Lorsqu’il se réveilla au milieu de la nuit, le dos douloureux, il crut un instant que Josquin avait à son tour disparu mais d’insupportables miaulements plaintifs, dignes du blues ou de la gwerz, lui parvinrent du vestibule. Le chat vagissait inlassablement devant la porte d’entrée et il le fit sortir avant de se coucher, cette fois dans son lit.
Alphonse avait peut-être une vie onirique plus riche que sa vie amicale et sentimentale mais il ne pouvait en être totalement sûr tant ses souvenirs de rêve étaient lacunaires — parfois seulement s’éveillait-il avec quelques images rémanentes totalement absconses qui témoignaient de rêves enfouis absurdes voire effrayants. En ce dimanche matin, lorsqu’il ouvrit les yeux, c’était une image de l’iceberg, le surnom du bâtiment des Archives où il travaillait, qui demeurait dans son esprit. L’iceberg flottait dans l’espace comme un vaisseau de science-fiction, cerné par les ténèbres, et il était sur le toit, seul au milieu des grandes statues de granit qui dominaient le bâtiment ; il serrait sur sa poitrine une grande bouteille de bière et semblait chanter quelque chose, la tête levée vers le vide sidéral. Alphonse s’étira et les volutes du rêve s’évanouirent. Il prit un café et écouta le journal de huit heures sur France culture ; le journaliste, l’air épuisé, égrenait d’une voix molle les grands disparus de la veille et les chiffres officiels : deux nouveaux ministres avaient été effacés et à peu près 80 % de la population semblait manquer à l’appel ; le président Valéry Giscard d’Estaing assurait que les sites stratégiques et sensibles étaient la priorité et que tout était mis en œuvre pour que les survivants soient répartis en fonction de leurs compétences (un accident nucléaire était survenu l’avant-veille en Ukraine) ; le camerlingue, qui assurait l’intérim après la disparition du Pape, appelait à de nouvelles grandes prières expiatoires et des groupes de flagellants circulaient dans Paris. « Bref, c’est le chaos », dit Alphonse à voix haute en coupant le transistor. Il enfila son manteau pour aller chercher le pain dans une des seules boulangeries encore ouvertes et sortit sur le palier où une odeur désagréable lui fit faire une grimace, Josquin miaula et Alphonse vit son chat, assis sous le cadavre de Paul, l’habitant du n°87, pendu dans le corridor. L’archiviste soupira et observa la face violacée de son voisin. Il s’était mordu la langue pendant l’agonie et elle pendait un peu sur la gauche comme si Paul avait essayé une dernière grimace comique avant la mort. Alphonse rebroussa chemin et tenta d’appeler la police. Après d’interminables sonneries, une voix lasse lui répondit que quelqu’un passerait aujourd’hui, peut-être demain, ils étaient débordés, surtout qu’il ne touche à rien, enfin on allait s’en occuper de Paul mais ils étaient nombreux à avoir sauté d’un pont ou à s’être fait sauter le caisson, une vraie épidémie, bordel le policier était fatigué, vraiment fatigué. Alphonse compatit, sortit à nouveau de l’appartement et contourna précautionneusement le cadavre. Il marcha dans les rues vides jusqu’au bourg de Kérinou où personne ne ferait plus la queue devant la boulangerie. « Horreur ! Le vieux monde s’écroule ! » — ces quelques mots de Saint Jérôme lui passèrent dans la tête alors qu’il poussait la porte vitrée du commerce.



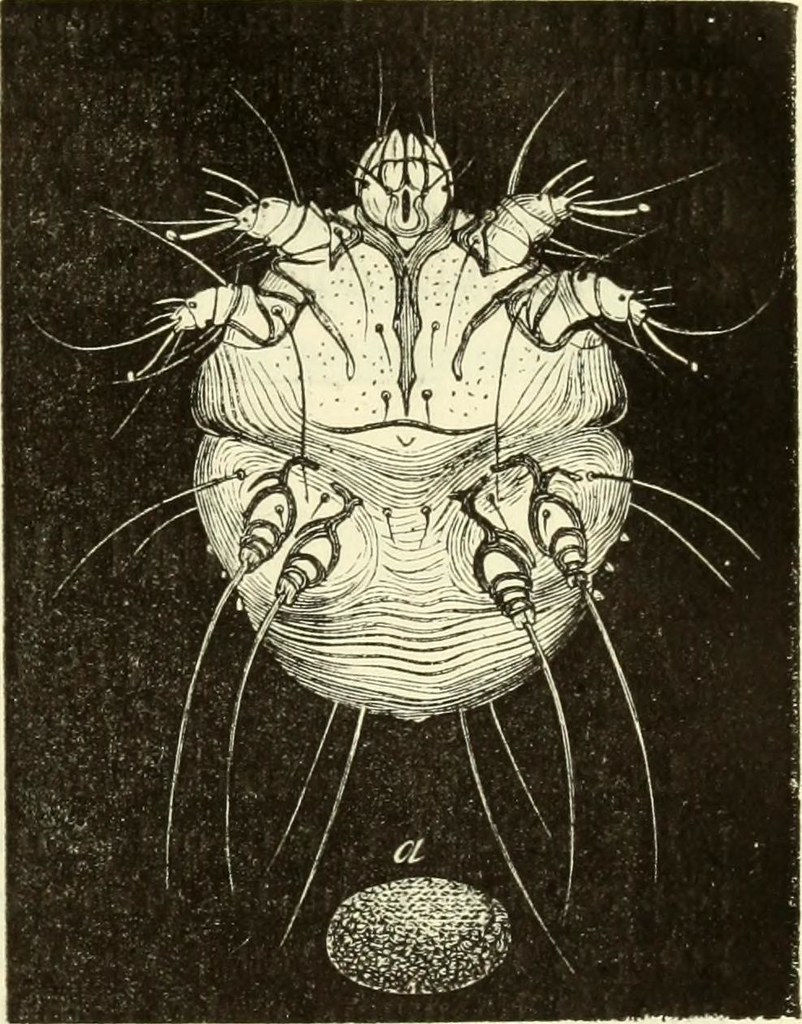

Comments